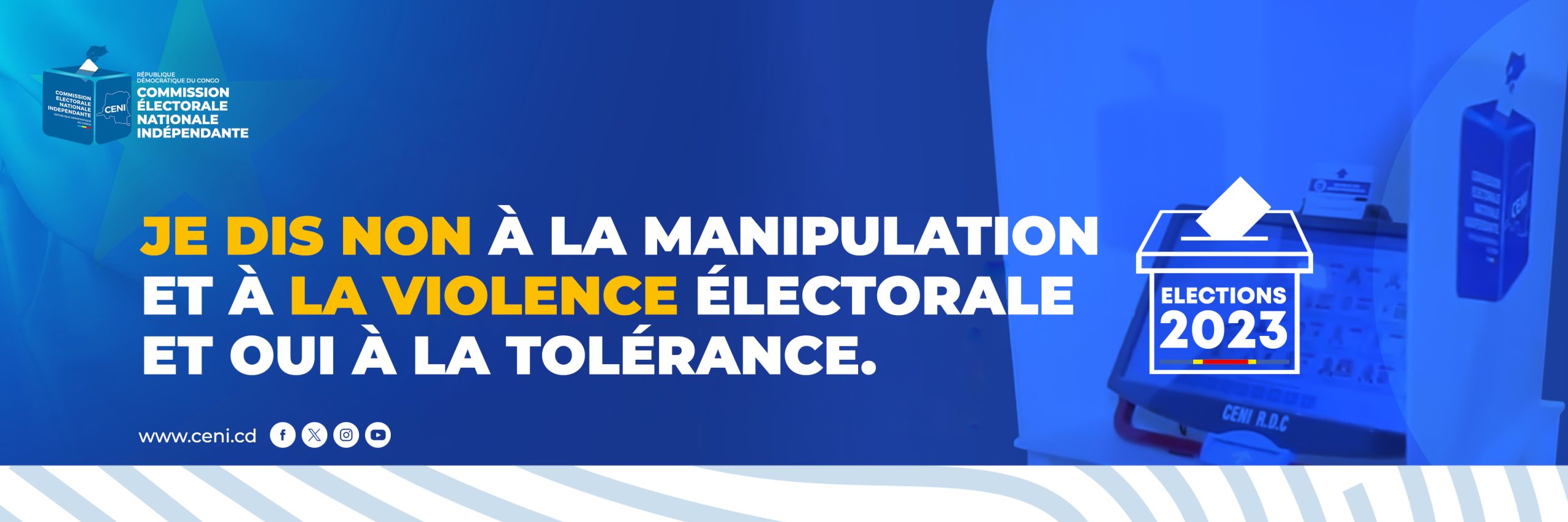Consciente de son rôle de sapeur-pompier, l’Eglise dans sa globalité ou, mieux, regroupée au sein de la plateforme Confession religieuse a, depuis la nuit des temps, préféré jouer la note de l’équilibriste entre des forces politiques en présence en vue de ne pas compromettre les chances de la paix.
Autant les Confessions religieuses trouvaient risquant de cautionner la logique du chaos, autant ils refusent d’apporter leur soutien à toute démarche en dehors de la constitution. D’où leur implication dans tout le processus de démocratisation à travers les élections pluralistes en RDC.
Il convient de souligner que devant pareil cas de figure, le poids de l’Eglise au sein de l’opinion nationale a toujours été vu comme suffisamment grand pour faire le contrepoids si celle-ci adhérait sans réserve aux résolutions politiques historiques.
Le 30 juillet 2006 a été une journée historique pour RD Congo, pays meurtri par plusieurs années de conflit entre différents belligérants. Ce jour, pour la première fois depuis 46 ans, les Congolais se sont rendus massivement aux urnes pour se choisir librement et dans la transparence leur futur président et les députés qui siègeront à l’Assemblé nationale de la troisième République.
Pour accompagner ces élections, la présence de plusieurs intervenants au processus a été de mise. Les Confessions religieuses, en dépit de leur apport au processus électoral, ont été considérées par les pouvoirs publics comme des groupes de pressions. Néanmoins, un groupe de pression n’a pas pour ambition de conquérir le pouvoir politique et l’exercer à l’instar des partis politiques. Il agit plutôt sur le fonctionnement des pouvoirs publics pour les influencer dans le sens qui sert ses intérêts.
Les interventions des Eglises et communautés de foi dans le champ politique ont été rendues possibles grâce au principe de la laïcité de l’Etat. Si la laïcité a été comprise comme la séparation de l’ordre temporel de l’ordre divin, elle n’a cependant pas exclut des interactions entre les deux ordres. La question de la séparation entre l’Eglise et l’Etat, qui est à l’origine de la modernité, n’a pas été comprise de la même façon par les acteurs concernés.
En République démocratique du Congo, les Eglises et la communauté musulmane regroupées dans le cadre de la plateforme Confessions religieuses ont pris une part active au processus électoral lancé depuis 2006. Il s’agit de l’Eglise Catholique, de l’Eglise du Christ au Congo (ECC), de l’Eglise Orthodoxe, de l’Eglise Kimbanguiste, de la Communauté Islamique, de l’Eglise du Réveil du Congo (ERC), de l’Union des Eglises Indépendantes du Congo et de l’Armée du Salut.
Sous une organisation dénommée « Confessions religieuses », ces Eglises et communautés de foi n’ont pas été à leur première occurrence. En 2006, les Confessions religieuses s’étaient déjà mobilisées pour les élections tant en amont qu’en aval. Les catholiques et les protestants avaient déjà démontré, à plusieurs reprises, leur puissance politique et leur capacité de mobilisation. Ils ont joué un rôle déterminant dans l’opposition à Joseph Kabila, en particulier dans le mouvement contre la prolongation de son mandat. Le Comité laïc de coordination notamment, en première ligne dans l’organisation des marches et manifestations, a pu être un allié précieux pour l’UDPS de Tshisekedi en 2011.
Le 28 novembre 2011, la RDC organisait ses secondes élections nationales de la Troisième République, après celles de 2006. Ces élections, majoritairement financées par le Gouvernement congolais, ont été un échec sur le plan organisationnel et politique. Les résultats de ces élections ont été qualifiés de peu crédibles par des missions d’observation électorale.
Les autorités et institutions issues des élections de 2011 ont régulièrement fait face à des questionnements sur leur légitimité. Ainsi, l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et son président Etienne Tshisekedi, candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2011, ont fait de la « vérité des urnes » leur cheval de bataille, allant pour ce dernier, jusqu’à s’autoproclamer président. La vérité des urnes a aussi été réclamée par l’Eglise Catholique congolaise à travers la Conférence épiscopale national du Congo (CENCO). De nombreuses violations des droits humains, dont les principales victimes étaient des membres des partis politiques d’opposition, des défenseurs des droits humains et des journalistes, ont accompagné les contestations des résultats du scrutin, ainsi que la période pré-électorale.
Ainsi, malgré l’organisation des élections, le pays a continué de souffrir de la réduction des espaces démocratiques, de la mauvaise gouvernance, de l’impunité, et des crises récurrentes de légitimité. Lorsque le mandat du président Joseph Kabila a expiré en novembre 2016, le gouvernement a
déclaré qu’aucun transfert de pouvoir ne pourrait être organisé parce que les élections étaient bloquées pour des raisons techniques et financières.
Lors du Dialogue piloté par Edem Kodjo à la Cité de l’Union africaine, l’Eglise catholique a refuté toute forme de Dialogue qui ne tiendrait pas compte des prescrits constitutionnels. Particulièrement des verrous consacrés par la loi fondamentale congolaise. Il s’est agi en particulier de l’article 220 ainsi que du principe d’alternance. Les évêques menaçaient de suspendre leur participation au Dialogue si aucune garantie n’était donnée quant au strict respect de la constitution.
Le Secrétaire général de la Cenco l’a fait savoir à l’opinion nationale. Une mise en garde ferme et sans appel qui a eu le mérite de faire réfléchir la classe politique congolaise. Force était de reconnaître qu’en l’absence du Rassemblement, la présence de l’Eglise catholique à la Cité de l’OUA servait d’indéniable caution au forum présidé par Kodjo.
La Constitution prévoyait que des élections présidentielle et législatives soient organisées avant le 27 novembre 2016, mais n’ont pu l’être en raison de la saisine par la CENI de la Cour constitutionnelle aux fins d’obtention de l’autorisation de reporter les élections afin de constituer un nouveau registre électoral.
Signé le 31 décembre 2016, l’Accord de la Saint-Sylvestre a défini une feuille de route du partage du pouvoir pour la période de transition jusqu’à la tenue des élections au plus tard le 31 décembre 2017. L’Accord contraint le président Kabila à renoncer à un troisième mandat, interdit les amendements constitutionnels pendant la période de transition, et prévoit certaines mesures destinées à apaiser les tensions politiques, notamment la libération des prisonniers politiques et la nomination d’un membre de l’opposition au poste de Premier ministre.
Deux camps se dessinent. D’un côté, un bloc formé par les représentants de l’Église catholique – la Cenco – et ceux des protestants – l’Église du Christ au Congo (ECC) –, qui réclame une suspension des discussions et demande des « compléments d’information » sur certains des cinq prétendants retenus comme candidats ; de l’autre, les représentants des six autres confessions religieuses – l’Église orthodoxe du Congo, l’Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, la Communauté islamique en RDC, l’Église de réveil au Congo, l’Union des Églises indépendantes et l’Armée du salut.
La charte régissant le processus prévoit, faute de consensus, de recourir au vote. Les représentants de ces six dernières confessions, s’étant mises d’accord sur leurs candidats, ont considéré que ce vote avait eu lieu et en ont déposé la liste à l’Assemblée nationale, qui doit désormais statuer.
La Ceni étant l’organe clé de l’organisation de la présidentielle de 2023, à laquelle Félix Tshisekedi, envisagerait un nouveau mandat, il l’a confirmé, sera candidat, la controverse en cours a, sans surprise, largement débordé les seuls cercles des représentants religieux. Du Front commun pour le Congo, de Joseph Kabila, à Ensemble pour la République, de Moïse Katumbi, en passant par l’Union pour la nation congolaise, de Vital Kamerhe, ou encore la coalition Lamuka, de Martin Fayulu, et Adolphe Muzito, la levée de boucliers a été générale, toutes ces formations politiques réclamant qu’un consensus soit trouvé.
En toute chose, en ce qui concerne la prise de décision, les chefs des confessions religieuses recherchent de bonne foi le consensus comme mode de prise de décision par excellence. À défaut du consensus, ils font recours à un vote transparent. En cas de vote, chaque confession religieuse exprime une seule voix. Dans ce contexte hautement inflammable, dans une RDC où les confessions religieuses ont de longue date leur mot à dire dans les affaires politiques, la question de leur représentativité se pose avec acuité.
Sur ce point, une étude menée par le cabinet Target, en 2020, avait apporté des réponses très précises. Sur les près de 2 000 Congolais interrogés en mars 2020, 34 % se réclamaient de l’Église catholique, 22 % se déclaraient protestants, pour 10 % de pentecôtistes et 5 % de branhamistes. Les musulmans seraient, à en croire cette étude, 3 %, pour 2 % de kimbaguistes. Les méthodistes et néo-apostoliques étaient crédités dans cette étude de 2 % également.
La rédaction